Cueillir n’est jamais un geste anodin.
Les humains ont chassé et cueilli pour se nourrir pendant plus d’un million d’années, jusqu’à il y a environ 10–12 000 ans, soit plus de 90% de l’histoire de notre espèce et de nos ancêtres, avant l’apparition de l’agriculture sédentaire. L’agriculture et l’élevage, avec des sociétés fixées sur un territoire, ne représentent qu’une infime fraction, très récente, de cette histoire : quelques millénaires seulement à l’échelle du genre Homo.
Dans cette profondeur temporelle, cueillir était la norme, intimement liée à la survie et à une connaissance fine des milieux. Pour beaucoup de peuples autochtones, pour ne citer que ceux d’Amérique du Nord ou d’Amazonie a titre d’exemple, ce geste n’a d’ailleurs jamais été réduit à un simple prélèvement utile : cueillir, c’est entrer dans une relation de réciprocité avec des êtres vivants, des « parents » ou des « personnes‑plantes » dotées d’esprit, avec lesquelles on échange prières, offrandes et soins au lieu, en retour de la nourriture ou de la guérison reçues. La règle centrale – prendre seulement ce dont on a besoin, laisser le reste pour la régénération et pour les autres – etait spirituelle, et avant même l’existence de la notion, écologique.

Cette vision contraste avec la conception occidentale moderne, qui a séparé radicalement « nature » et « culture ». Comme l’a montré Philippe Descola dans « Par‑delà nature et culture », cette opposition est une construction spécifique de l’Occident, pas une évidence universelle : d’autres sociétés n’ont jamais isolé les humains d’un côté et les plantes ou animaux de l’autre. Dans ce naturalisme, la plante devient facilement stock de « biodiversité » ou ressource à gérer. À l’inverse, les cosmologies autochtones et les pratiques de cueillette qu’elles portent voient la plante comme un partenaire avec lequel on compose un monde habitable, dans une relation de dons, de limites et de responsabilité partagée.
Aujourd’hui dans ce quotidien occidental : de manière très répandue, la déconnexion au vivant se lit dans les gestes les plus banals. On remplit un caddie, on scanne des codes‑barres, on range dans un frigo des légumes anonymes. Le plus souvent, nous ne connaissons ni la personne qui a semé ou récolté, ni le lieu où la plante a poussé, ni les conditions de sol, d’eau, de travail qui ont rendu possible cet aliment. L’origine se résume à une étiquette : pays, calibre, date. Manger devient un geste fonctionnel, très souvent distrait.
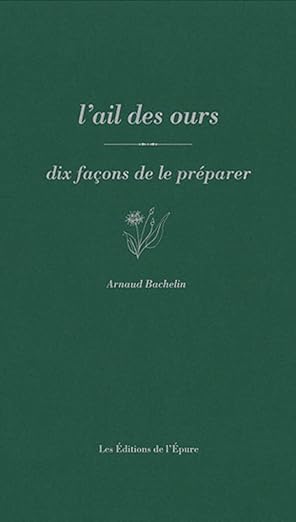
La rareté actuelle de la cueillette n’empêche pourtant pas des engouements soudains, déclenchés par les réseaux sociaux. L’exemple de l’ail des ours est parlant : Arnaud Bachelin, Tea-Master et auteur d’un petit livre de recettes « Dix façons de le préparer: l’ail des ours », racontait que son ouvrage se vendait à peine, jusqu’au jour où un influenceur a mis en avant cette plante. En quelques saisons, certaines forêts voient affluer des cueilleurs improvisés, parfois peu formés, avec des prélèvements massifs et, localement, de véritables « carnages » sur les stations les plus accessibles. La cueillette, geste ancestral de subsistance et de lien, se transforme alors en extraction opportuniste, au rythme des modes et des recettes virales.
Dans ce contexte, la question devient brûlante : que signifie cueillir aujourd’hui ? Est‑ce simplement prendre, ou entrer en relation ? Au jardin comme en sauvage, la cueillette nous invite à ralentir, observer, écouter. Elle suppose de reconnaître les plantes, leurs habitats, leurs saisons, mais aussi leurs fragilités : ne pas prélever les espèces rares ou protégées, respecter les lois locales, accepter parfois de ne rien prendre. Cueillir devient une éthique en acte : on ne ramasse pas « ce qui traîne », on répond à une rencontre. Et lorsque je mange ce que j’ai cueilli ou cultivé, le goût se charge d’histoire : un sentier, une lumière, une sécheresse, une veille de gel, une décision de laisser une partie intacte.
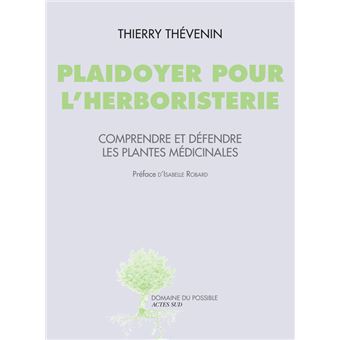
Des paysans‑herboristes comme Thierry Thévenin rappellent que la cueillette ne peut être qu’« humble » : connaître les plantes, leurs cycles, leurs milieux ; ne prélever qu’une partie de la population ; laisser de quoi assurer la reproduction ; renoncer aux sites fragiles ou surexploités. Pierre Lieutaghi, lui, insiste sur le fait que la relation aux plantes est d’abord une relation de nécessité : nous ne survivons pas sans elles, et chaque geste de cueillette reconfigure les sols, les eaux, la flore. Cueillir n’est plus un droit abstrait, mais une responsabilité concrète : chaque poignée de feuilles, chaque fleur coupée laisse une trace dans le paysage.
C’est là que ce geste rejoint la pensée de Baptiste Morizot. Il parle de « nouvelles alliances » avec les vivants et de diplomatie avec eux : apprendre à ajuster nos gestes (cueillir, cultiver, accéder à un territoire) à l’altérité des autres êtres. La cueillette devient alors une forme de diplomatie de terrain entre humains et plantes : négocier usages, limites, rythmes, accepter de ne pas tout prendre, de ne pas tout savoir, de se laisser instruire par la manière dont chaque plante habite un lieu.
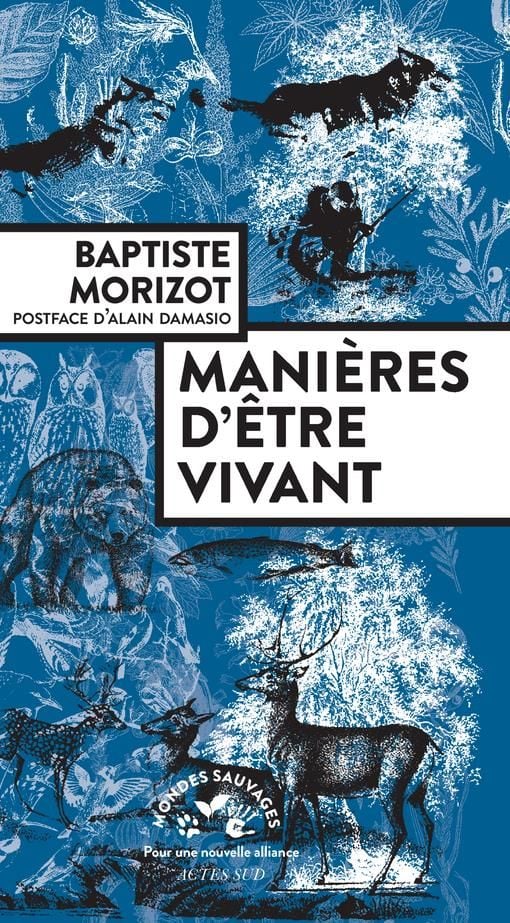
Dans un monde où tout s’extrait et se standardise, la cueillette – telle que la vivent et la pensent Bachelin, Thévenin, Lieutaghi, mais aussi, plus largement, Descola ou Morizot – peut redevenir un art politique discret : celui de recevoir sans épuiser, de transformer sans abîmer, de remercier sans posséder. Elle incarne, à petite échelle, une mutation de notre rapport au vivant : sortir de la nature‑stock, retrouver la densité d’un aliment situé, et faire de chaque cueillette une micro‑diplomatie qui répare un peu la rupture entre le supermarché et la forêt, entre le caddie et la clairière.